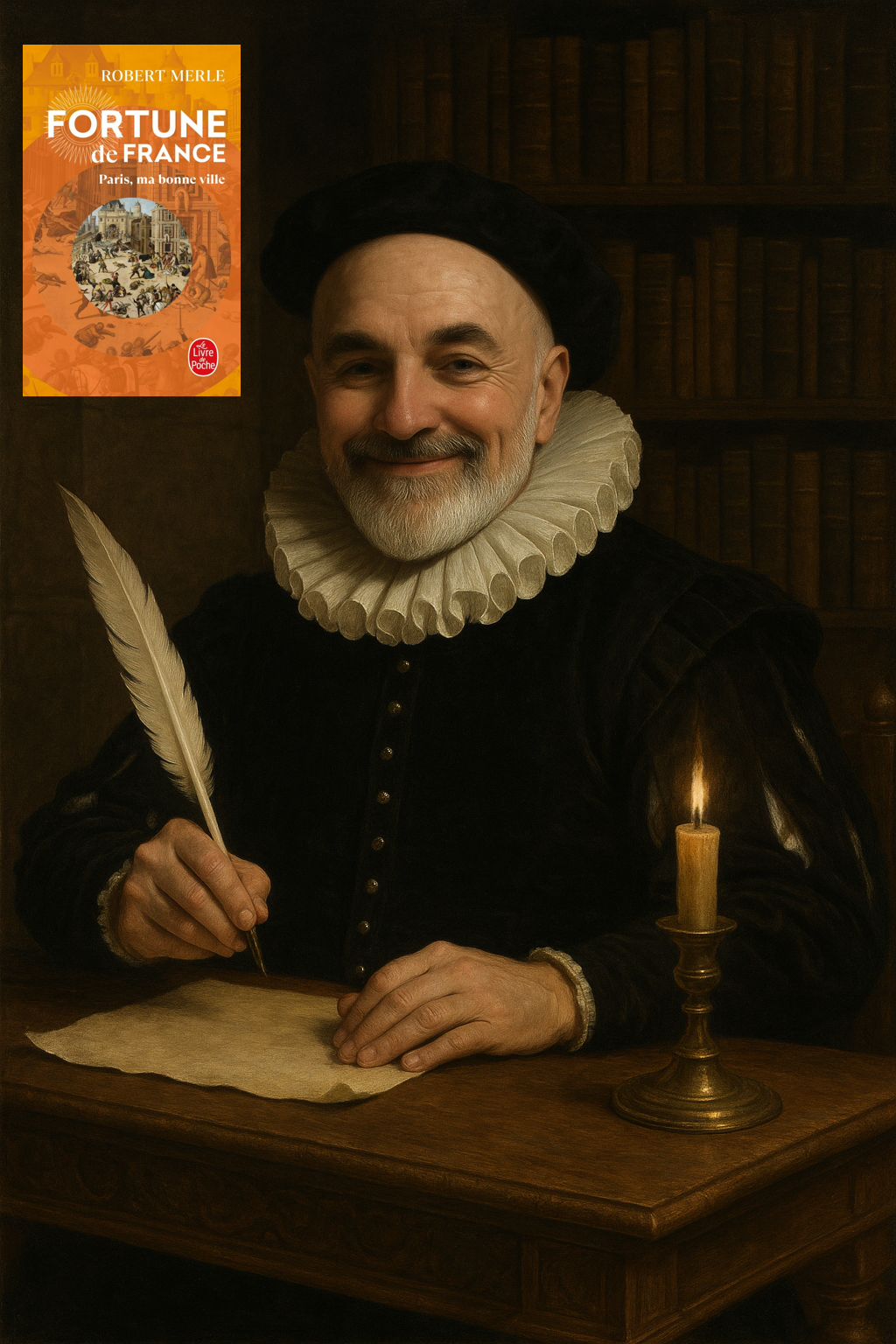
Mon avis sur « Paris ma bonne ville » dans la série « Fortune de France » de Robert Merle.
Il s’agit du troisième opus, dans une série qui en compte treize !
Autant dire que je vais pouvoir me délecter encore longtemps du style unique de Robert Merle, qui nous plonge avec délices dans le passé, en usant d’un langage emprunté au XVIe siècle, qu’il faut certes apprivoiser mais qui devient naturel au fur et à mesure de la lecture au point que l'on tombe sous le charme de ses tournures poétiques.
« Paris ma bonne ville » est donc un roman qui s’appuie largement sur des faits historiques, très bien relatés, au travers du regard et des aventures de Pierre de Siorac, très jeune médecin, fils cadet du baron de Siorac, dont la baronnie se situe en Périgord noir, dans la seigneurie de Mespech.
Vous avez peut-être découvert « Fortune de France » par l’adaptation très réussie produite par France télévisions et que l’on a pu voir il y a quelques mois. Pour autant, lire les œuvres de Robert Merle apporte encore bien davantage de plaisir.
Pierre de Siorac, tout comme son père, est huguenot (protestant), mais porte au cou une médaille de la Sainte Vierge, que sa mère, catholique, lui a demandé sur son lit de mort de porter toute sa vie, serment qu’il a juré de respecter. Dans ce siècle de déchirement religieux et d’intolérance, le jeune Pierre de Siorac se montre tolérant, et admet que son propre parti huguenot n’est pas plus vertueux que le camp des papistes.
Il a assisté à Nîmes au massacre des Catholiques par les Protestants, lors d’une journée appelée « Michelade » le 30 septembre 1567, et se retrouve à Paris, cinq ans plus tard, la veille de l’épouvantable massacre de la Saint-Barthélemy, la nuit du 24 août 1572, où cette fois les catholiques s’en prirent aux protestants, dont beaucoup de princes huguenots, qui s’étaient rendus dans la capitale pour le mariage de la sœur du roi Charles IX, Marguerite (plus connue sous le nom de reine Margot), avec le roi Henri de Navarre, futur Henri IV de France.
Le récit est riche, haletant, plein de suspense, même si l’on connaît l’histoire. L’atmosphère, les tensions politiques et sociales, jusqu’au déchaînement de violence, sont très bien rendues. Pierre de Siorac nous en apprend beaucoup sur le Paris de cette époque et l’état d’esprit des Parisiens, dont certains traits de caractère ont traversé les siècles… Et pas toujours à leur avantage.
Durant cette nuit terrible, les portes et les ponts de la capitale étant fermés pour empêcher les Protestants de fuir, Pierre de Siorac et les proches amis qui l’accompagnent devront faire preuve de beaucoup de hardiesse, de ruse, de courage, pour échapper aux massacreurs, des petits-bourgeois et artisans devenus d’infâmes tueurs, plus appâtés par le pillage que par la cause qu’ils s’étaient donnée prétexte de défendre. On vit (du verbe vivre) littéralement leurs peurs, leurs fuites, à travers les rues anciennes de Paris qui sont toutes nommées et décrites, on partage leurs silences dans leurs caches improvisées, leurs rencontres insolites, leurs combats quand ils ne peuvent faire autrement pour se défendre. Cela vaut n’importe quel thriller d’aujourd’hui.
Mais à côté de ce récit épique, l’auteur n’oublie pas la tendresse, l’amour, qui s’invite dans le quotidien du héros et de ses proches, pour pimenter encore une histoire finalement très humaine, et qui pourrait aisément se situer à notre époque.
Et pour finir, un petit extrait, pour vous donner une idée du style, et l’état d’esprit du jeune et vaillant Pierre de Siorac :
« Quant à Notre-Dame, je fus, en la voyant, de merveille et d’étonnement ravi, mais ne la veux décrire céans : il y faudrait un livre. Et encore que je fusse en ma foi huguenote rebuté par tant d’images idolâtres, soit sur les vitraux peints, soit en hautes statues façonnées, je ne laissai pas de les trouver si belles que je n’eusse pas voulu qu’on les brisât, comme firent en tant d’églises les furieux de mon parti, mais bien au rebours, qu’on les préservât pour l’admiration de nos fils, sans toutefois leur rendre un culte qui n'est dû qu’à Dieu seul. De reste, à ne les considérer non comme des objets sacrés, mais comme des représentations de l’homme, il me semble qu’on les aimerait davantage, en ne les adorant pas ».
Bonne journée à tous !
Jean